MGTOW : Des hommes sans femmes
MGTOW : Des hommes sans femmes
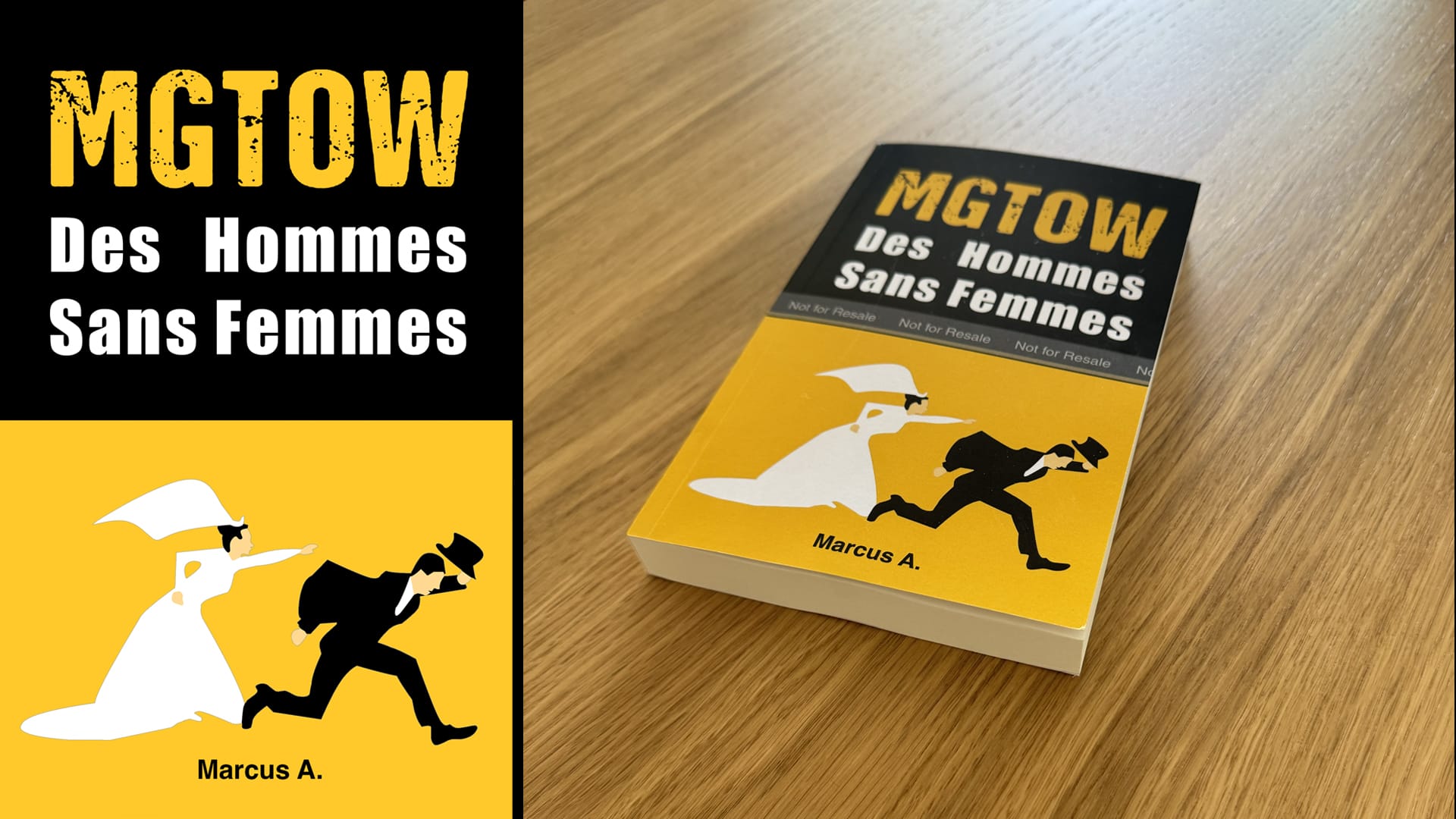
Ce livre est disponible sur 👇
Amazon – version papier et Kindle - https://amzn.to/3JIBcfy
Kobo – version eBook - https://www.kobo.com/fr/fr/ebook/mgtow-des-hommes-sans-femmes
Et si un nombre croissant d’hommes choisissait de se retirer du jeu ?
Dans un contexte de transformation profonde des dynamiques conjugales, un phénomène discret mais massif émerge : des hommes issus de tous les horizons socioculturels, lucides et désillusionnés, prennent leurs distances avec les normes relationnelles traditionnelles. Déclin du mariage, désaffection du couple, scepticisme à l’égard de la paternité. Une forme de retrait volontaire s’installe. Et ce retrait porte un nom : MGTOW – Men Going Their Own Way.
Ce mouvement, encore largement marginalisé dans les discours publics, repose sur un constat dérangeant : dans un marché sexuel devenu instable, asymétrique et souvent biaisé par les effets cumulatifs de l’hypergamie, des réseaux sociaux et de l’asymétrie normative entre les sexes, le contrat implicite entre hommes et femmes semble avoir été unilatéralement révoqué.
Dans cet essai incisif, Marcus A., alias L’Observateur – figure discrète mais influente du web francophone – explore les nouvelles conditions de l’intimité masculine dans un monde postmoderne. S’appuyant sur son expérience personnelle et sur une vaste littérature sociologique, psychologique et philosophique, il décrypte les ressorts profonds de ce malaise masculin.
À travers des concepts clés comme l’hypergamie, la loi de Briffault, la misère sexuelle et le capital sexuel numérique, l’auteur met en lumière un déséquilibre vécu par des millions d’hommes – souvent sans les mots pour l’exprimer.
Plus qu’un pamphlet, ce livre est une tentative de cartographier un monde relationnel en mutation. Il interroge :
– Que signifie être un homme aujourd’hui ?
– Pourquoi autant d’hommes choisissent-ils de ne plus s’engager ?
– Et surtout : comment redevenir acteur dans un environnement qui semble vous avoir marginalisé ?
Un essai à contre-courant.
À lire pour comprendre une fracture silencieuse – mais croissante.
Quelques extraits du livre qui vous donnent un aperçu du contenu, du style et de la voix narrative.
Chapitre 1 : La Sonate à Kreutzer
L’air vif du matin effleure mon visage tandis que je gravis la rue Jeanne-d’Arc en direction de la gare de Rouen-Rive-Droite. Le train de 6 h 50 en provenance du Havre marque une courte pause avant de reprendre sa course vers Paris-Saint-Lazare. Cette routine matinale est réglée comme du papier à musique : réveil à 5 h 30, petit-déjeuner à 6 h 20, après m’être mécaniquement rasé, douché, habillé. À 6 h 35, je franchis la porte de mon studio, place du Vieux-Marché. Un ballet quotidien, orchestré avec une précision militaire. Arrivée prévue à Paris : 8 h 20.
Depuis des mois, le Paris-Normandie fait partie intégrante de ma vie. Ce train est devenu mon lien quotidien avec Paris, la ville de mes ambitions. À 23 ans, je déborde d’énergie et d’aspirations, comme peut l’être un jeune homme à cet âge – plein de rêves et de testostérone.
J’ai quitté un poste d’architecte dans un modeste cabinet normand pour une opportunité plus prometteuse dans une grande agence parisienne. Ce changement marque le début de ma quête de grandeur, pour moi qui ai toujours été ambitieux. De toute manière, cela dépasse cette question. Paris est un passage quasi obligatoire pour tout architecte qui souhaite se constituer un CV digne de ce nom. La France étant un pays hypercentralisé, tout se passe à Paris : les grandes écoles, les grandes entreprises, les meilleures opportunités, les meilleurs salaires. Et l’architecture ne fait pas exception. Pire, cette discipline est une caricature du système centralisé. Sur les vingt-deux écoles d’architecture en France, six parmi les plus grandes se trouvent à Paris, dont La Villette et Paris-Val-de-Seine. Et sur les cent plus grandes agences d’architecture en France, plus de soixante se trouvent dans la capitale, selon le classement des agences d’architecture publié chaque année par la revue D’A. D’architectures.
Toutefois, si je n’ai pas rencontré de difficulté à trouver un emploi, m’installer dans la Ville Lumière se révèle plus ardu. La recherche d’un logement est un parcours du combattant qui se solde par un échec. Les appartements que je visite oscillent entre fraîchement rénovés et pratiquement insalubres – ce qui constitue la majorité. Parmi ces visites, une reste particulièrement mémorable. L’agent immobilier, avec un brin de fierté, me présente une trouvaille du propriétaire : des toilettes à la turque avec un caillebotis rabattable pour se doucher – une ingéniosité peu convaincante. Une autre fois, c’est un studio au plan improbable : une cabine de douche en PVC blanc dans un coin de la cuisine, coincée entre le plan de travail et le frigo ; les toilettes se trouvent sur le palier, bien sûr. Malgré leur état lamentable, ces logements sont soumis à des conditions de location surréalistes : certains propriétaires demandent deux garants, d’autres un an de loyer payé d’avance. L’un des plus excentriques ne loue qu’aux enfants de fonctionnaires – c’est pour lui un gage de sécurité. Évidemment, c’est tant pis pour moi.
Ces pratiques sont bien entendu illégales, mais dans un marché parisien saturé par une demande en hausse exponentielle, les tickets d’entrée demeurent rares et les candidats nombreux. Certains propriétaires l’ont compris et en abusent sans honte. Malgré un CDI en poche et un salaire convenable dépassant trois fois le montant du loyer, je ne parviens pas à faire accepter mon dossier.
Suite à cette expérience – et plusieurs mois perdus à tenter désespérément de trouver un logement décent –, je me résigne. Les visites de studios insalubres (pendant ma pause déjeuner et bien souvent après le travail) ont fini par avoir raison de ma motivation initiale et de ma patience.
C’est ainsi que je suis parvenu à la conclusion suivante : pourquoi ne pas continuer à vivre à Rouen et travailler à Paris ? Après tout, je ne suis pas le seul à faire l’aller-retour quotidien. Des milliers de voyageurs empruntent ce trajet chaque jour ; communauté silencieuse partageant le même sort.
Bientôt, je commence à reconnaître les visages familiers du 6 h 50. Nous échangeons des sourires complices, voire quelques mots dans la cohue d’un train bondé. Il m’arrive souvent de ne pas trouver de place assise ; je passe donc l’heure et demie de trajet debout, ou assis au sol dans l’espace entre les deux wagons. La SNCF vend visiblement plus de tickets que de places disponibles. Peut-être, aussi, que beaucoup voyagent sans ticket – par manque de moyens ou pour le plaisir de la fraude. Quoi qu’il en soit, à la fatigue du réveil matinal et du trajet vient s’ajouter le stress du transport.
Mais ce jour-là, je trouve une place assise. C’est un vendredi, et le train est moins bondé que de coutume. J’ai déjà constaté qu’ils sont nombreux à opter pour le télétravail, avant même que cela ne devienne une mode. D’autres prennent leurs RTT le vendredi. Beaucoup parviennent à négocier une semaine de travail de quatre jours, en faisant quelques heures supplémentaires chaque jour. C’est ce que me racontent les quelques personnes avec lesquelles j’ai eu l’occasion d’échanger au cours de mes trajets.
Quelle que soit la raison de cette bénédiction du vendredi, je m’installe confortablement dans mon siège. J’ai pris l’habitude d’observer les passagers : certains reprennent leur sommeil écourté, d’autres lisent les nouvelles, d’autres encore sombrent dans leurs pensées. Quant à moi, j’ai pris l’habitude de mettre à profit ce temps de trajet quotidien pour lire et apprendre de nouvelles choses.
Je me plonge donc une fois de plus dans les pages de La Sonate à Kreutzer. Dans cette nouvelle, Tolstoï raconte avec une crudité rare et un ton provocateur les tumultes émotionnels et les conflits moraux d’un mariage consumé par la jalousie et la suspicion. À travers Pozdnychev, le personnage central qui raconte son histoire à des passagers rencontrés dans un train – ce détail me fait sourire –, l’auteur explore la complexité du mariage et de la sexualité. La relation de Pozdnychev à sa femme, initialement empreinte de passion, se détériore progressivement. On assiste alors à l’érosion d’un couple, exacerbée par la jalousie et l’incompréhension mutuelle. La narration atteint son apogée lorsque Pozdnychev – sans preuve concrète, mais persuadé que sa femme le trompe avec un violoniste – la tue dans un excès de rage. On ne saura jamais si elle l’a réellement trompé. Pourtant, il est acquitté de ce meurtre ; probablement parce que le système juridique de l’époque estime que l’adultère – ou encore la défense de l’honneur – justifie le meurtre de sa femme. Il est important ici de rappeler que la nouvelle a été publiée en 1889 et qu’au travers de ce texte, Tolstoï critique les normes sociales de l’époque en mettant en lumière les dysfonctionnements et les hypocrisies de la société russe. La nouvelle est à la fois une méditation sur la nature destructrice de la jalousie et une critique acerbe des conventions sociales autour du mariage et de la sexualité dans la Russie du xixe siècle. Il pose une question audacieuse sur la nature même de l’amour et du mariage. Est-il possible pour deux êtres de rester unis et heureux toute leur vie ? Les conventions sociales sur le mariage et la fidélité reflètent-elles réellement la nature profonde des relations hommes-femmes ? Ou tout cela n’est-il, au fond, que chimère et hypocrisie ?
Alors que le train serpente vers la capitale, je m’identifie de plus en plus à Pozdnychev. Ses dilemmes reflètent mes propres incertitudes et interrogations sur la question du couple et du mariage. Comme lui, je me demande si le couple et le bonheur conjugal ne forment pas qu’une illusion, un idéal inatteignable. La violence psychologique que peut générer une relation de couple et les tourments émotionnels décrits dans cette nouvelle se trouvent aux antipodes de l’amour romancé et de l’harmonie idéalisée du mariage heureux. La relation entre Pozdnychev et sa femme peint au contraire un tableau plutôt sombre de la vie conjugale. Et c’est bien cela qui m’interpelle chez Tolstoï : la froideur et le réalisme de son constat.
Pozdnychev reste convaincu que l’amour romantique n’est pas de ce monde. Tout au plus concède-t-il l’existence d’une attirance physique, bien qu’éphémère, capable de tromper les plus crédules. D’ailleurs, il se satisfait pendant longtemps de relations sexuelles tarifées, avant de se risquer à espérer une relation apaisée avec une fille bien sous tous rapports. Il profite ainsi des premières joies de l’amour, avant que le déclin, les morsures de la jalousie, les suspicions d’adultère et la haine entre les protagonistes n’aboutissent au dénouement tragique de l’intrigue.
La Sonate à Kreutzer n’est pas qu’une œuvre littéraire pour moi ; c’est un miroir de mes propres questionnements. Comme Pozdnychev, je suis convaincu que l’amour véritable – et son ambition d’éternité maritale – est une illusion naïve. Je ne comprends pas la logique même du mariage et reste interpellé par le nombre croissant de divorces.
D’aussi loin que je me souvienne, le mariage de mes propres parents a toujours été une énigme. Ils étaient jeunes et très instruits, avec la vie devant eux. Pourtant, avec trois enfants en quatre ans, la vie fut difficile. Je ne retiens de mon enfance que des images de chaos : un jeune couple débordé par les tâches du quotidien, jonglant entre nous – moi l’aîné, ma sœur et mon petit frère – et leurs emplois du temps. Mes parents ne faisaient que travailler afin de maintenir les finances du foyer à flot. Ils ont certainement fait de leur mieux, mais Dieu que cela a été dur ! J’imagine que ce scénario est le lot de nombreux couples modernes, qui tentent de jongler entre vie familiale et obligations professionnelles. Mais cela n’en fait certainement pas un modèle idéal.
Aujourd’hui, je suis adulte et j’ai déjà connu mes premières expériences avec les femmes, mais de nombreuses questions persistent. Mes relations avec la gent féminine sont toujours restées brèves et légères. Je ne me vois pas du tout marié, avec des enfants, un chien et une maison, attendant sagement que la vie passe.
Tandis que Paris se profile à l’horizon, je referme mon livre. Encore quelques pages et j’aurai achevé ce voyage littéraire. Mais mon trajet ne s’arrête pas à la gare Saint-Lazare. J’ai encore devant moi un parcours en métro : la ligne 14 jusqu’à Châtelet, puis la ligne 1 jusqu’à Bastille, où mon agence d’architecture m’attend. Je sais déjà que je devrai trouver un nouveau compagnon de route pour mon retour. Ce long trajet – quasiment deux heures, porte à porte, depuis mon studio rouennais jusqu’aux bureaux parisiens – nécessite une grande quantité de livres pour occuper ces quatre heures de trajet quotidien, sans compter les nombreux retards et trains annulés qui prolongent mon temps de lecture.
Quoi qu’il en soit, la lecture de La Sonate à Kreutzer a ouvert les vannes de mes réflexions sur les relations hommes-femmes. Cependant, je ne le savais pas encore, mais c’est ma prochaine lecture qui provoquera une révolution profonde de cette vision.
Chapitre 2 : La découverte du « game »
Après ma journée de travail, je reprends le métro dans le sens opposé. Comme souvent, le train de 18 h 50 à destination de Rouen a du retard. Je décide donc de me rendre à la Fnac pour y dénicher mes prochaines lectures. Au détour d’un rayon, je tombe sur un livre à la couverture aguicheuse, intitulé The Game : Les secrets d’un virtuose de la drague. Je le prends sans trop savoir à quoi m’attendre et retourne à la gare où mon train a fini par arriver. Je prends place et me plonge dans cette nouvelle trouvaille avec avidité.
L’heure et demie de trajet semble se réduire à une poignée de minutes. Sans que je m’en aperçoive, le train arrive déjà en gare de Rouen-Rive-Droite. N’arrivant pas à décoller mes yeux de ce livre, je poursuis ma lecture quelques instants encore, alors que le train est arrêté en gare, puis me résigne finalement à le fermer et à descendre du wagon avant que le train ne poursuive son chemin vers Le Havre. Mais avec les quelques dizaines de pages que je viens de lire, je sais que je tiens entre les mains un livre qui relate une expérience plutôt atypique.
Dans The Game, Neil Strauss relate son infiltration journalistique du monde presque clandestin des pickup artists (PUA), une communauté secrète dédiée à l’art de la séduction. Il est engagé par le Rolling Stone Magazine afin de mener une enquête en immersion dans le monde de ces experts de la drague.
Strauss commence son aventure en s’inscrivant à un coaching de séduction. Là, il fait la connaissance de Mystery, un personnage aussi charismatique qu’énigmatique ; il est considéré comme une figure de proue dans la communauté des dragueurs. Cette rencontre marque le début d’un voyage intrigant, dans lequel Strauss explore les dynamiques internes, ainsi que les techniques surprenantes et jusque-là secrètes de ce groupe. Il y révèle les aspects controversés de cette culture underground, muée en une espèce de Fight Club de la drague.
Au cours de leur premier coaching, Mystery détecte le potentiel de Neil. Il le relooke et décide d’en faire son assistant. Il est d’usage, dans la communauté des pickup artists, d’utiliser un pseudonyme afin de ne jamais dévoiler son vrai nom. Neil devient alors Style.
Dès le début de l’ouvrage, on comprend qu’il faut vite s’habituer aux acronymes. Communs dans la culture anglo-saxonne, ils le sont encore plus dans la sous-culture PUA. Neil apprend donc qu’il est un AFC, soit un average frustrated chump (pauvre type moyen frustré) – c’est-à-dire un homme au physique banal, voire ingrat : petit, frêle, myope, le teint blême, les cheveux clairsemés. Pour couronner le tout, il souffre d’une timidité maladive.
Le premier conseil de Mystery, devenu son mentor, est de revoir son apparence. Neil Strauss est loin d’être un adonis, et son allure négligée n’arrange rien. Sans promettre de miracles, Mystery suggère tout de même d’optimiser ce qu’il peut. Il le débarrasse de ses affreuses lunettes aux verres épais comme des fonds de bouteille pour lui faire adopter des lentilles, lui conseille de se raser la tête pour transformer son crâne dégarni en tête lisse et soignée, choisit pour lui des vêtements plus tendance – du moins, selon les standards américains de la fin des années quatre-vingt-dix – et lui fait porter des chaussures à semelles compensées pour paraître plus grand. Pour parfaire l’ensemble, il ajoute des accessoires : colliers, bagues et une boucle d’oreille, assurant ainsi qu’il ne passerait jamais inaperçu. En consultant les photos de Neil Strauss – ou plutôt Style – après son relooking, on ne peut que reconnaître le succès de cette transformation physique. Et c’est là l’une des premières leçons du PUA : l’optimisation du potentiel !

Notre génétique est immuable. Vous ne serez peut-être pas le plus beau ni le plus grand, et vous n’y pouvez rien. Cependant, rien ne vous empêche d’optimiser ce que vous avez. Perdre du poids, manger sainement, faire du sport, développer une bonne musculature et un physique athlétique – si aucun handicap ne vous en empêche, bien entendu – est à la portée de tout le monde. Tout repose sur le respect que vous accordez à votre corps, le seul véhicule primordial de votre vie.
Il est important de souligner que les traits que l’on juge attirants – une belle peau, un teint éclatant, un corps svelte – ne sont, en réalité, que des manifestations visibles d’une bonne santé. Nos habitudes alimentaires, notre hygiène de vie et notre condition physique se reflètent naturellement sur notre apparence. Nous avons évolué pour percevoir, souvent inconsciemment, les signaux subtils que les corps émettent, révélateurs d’un organisme sain et de prédispositions génétiques favorables – autant d’indices du partenaire idéal sur le plan reproductif.
Mystery, quant à lui, se présente comme l’antithèse de Neil Strauss : un artiste doté d’un charisme et d’une intelligence certains, qui rêvait de devenir magicien. Il utilisait d’ailleurs ses tours de magie afin d’attirer l’attention des femmes en soirée. Il possède aussi une façon bien à lui de s’habiller : chapeau haut de forme, lunettes de ski sur le front, vernis à ongles noir, bagues et colliers de toutes sortes. Pour couronner le tout, alors qu’il est déjà très grand – 1,96 m –, il porte des chaussures compensées qui augmentent sa taille de 10 à 15 cm. De cette manière, il est certain de ne jamais passer inaperçu en boîte de nuit, lieu de prédilection pour ses séances de drague et ses cours pratiques. Il appelle cette technique le « peacocking », ce qui signifie « faire le paon » : une technique inspirée de son étude de l’évolution et du darwinisme, très présents dans les enseignements de Mystery. Selon lui, cela permet d’attirer l’attention des femmes à la façon du paon qui dévoile sa queue colorée, afin de prouver à d’éventuelles femelles ses qualités génétiques.
La particularité de Mystery – et la révolution qu’il apporte dans le domaine – réside dans sa transformation de la séduction en véritable science, qu’il a patiemment théorisée et qu’il ambitionne de transmettre comme un savoir structuré. Il analyse les rapports entre hommes et femmes avec une approche quasi scientifique, en s’appuyant notamment sur la psychologie évolutionniste, la biologie et l’anthropologie. De cette étude, il a tiré des techniques, des séquences, des routines et des principes, dont l’application méthodique est censée garantir à leurs utilisateurs un certain succès auprès des femmes. Il affirme pouvoir enseigner ces méthodes de manière scolaire, presque algorithmique, à travers des séminaires payants.
Son argument de vente est redoutablement efficace : peu importe votre physique, votre caractère ou votre âge, la séduction s’apprend, au même titre qu’une langue étrangère. Je dois reconnaître que cette promesse a quelque chose de particulièrement séduisant, notamment pour un public de jeunes hommes hétérosexuels perdus dans la complexité des relations amoureuses contemporaines.
Il faut dire que dans les sociétés anglo-saxonnes, la séduction n’a jamais été perçue comme un art naturel ou instinctif. Ce malaise culturel ne remonte pas seulement à l’époque victorienne ; il plonge ses racines dans le puritanisme protestant issu de la Réforme. Ce courant religieux valorise l’austérité, la retenue et la maîtrise de soi, identifiant toute expression corporelle ou sensuelle comme suspecte, voire peccamineuse. Le corps y est considéré comme un vecteur de tentation, et le désir comme une faiblesse à dompter. Cet héritage moral rigide laisse une empreinte durable sur les mentalités anglo-saxonnes, où la séduction demeure souvent teintée de culpabilité ou de maladresse. Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que l’approche mécanisée, presque désincarnée, de Mystery ait trouvé un écho favorable.